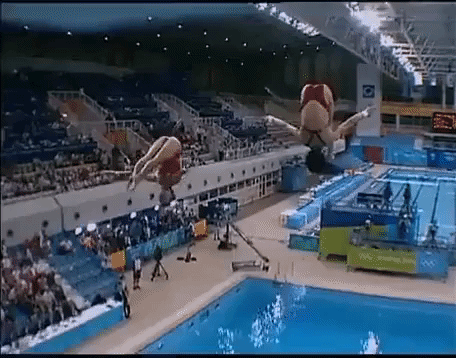Fais pas genre - De l'égalité dans l'orientation
Genre, éducation et orientation, un trio gagnant ?
Avec cette édition je te propose de plonger ensemble les eaux incertaines de l’(in)égalité homme-femme. En remontant d’abord à la source, pour comprendre quels sont ces biais de genre et leur origine. Puis, en sortant en eaux libres explorer comment œuvrer pour plus d’inclusivité.
La Ploufletter est un espace créé par La piscine pour parler quête de sens. Je t’y apporte contenu, ressources et outils pour apprendre à te connaître et construire une voie à ton image. Le tout sur fond de sociologie et mauvais jeux de mots. Athlète confirmé·e ou newbie en brassards, bienvenue 🎣
Tu verras, ici on évoque beaucoup le monde de la natation pour faire référence au fait de se lancer « dans le grand bain » de la vie. La piscine, c’est le monde – du travail le plus souvent. Le couloir de nage, c’est la voie que l’on choisit. Les différentes techniques de nages, les paliers que l’on passe. Enfin, les nageur·ses sont les personnes qui, comme toi et moi, sont en quête de sens. Si besoin, tu peux consulter ce lexique natatoire !
Tu peux aussi :
Plonger dans le carnet de jeu À l’eau pour lancer ton introspection,
Découvrir le programme introspectif de La piscine conçu pour t’aider à trouver ta voie·x,
T’abonner à la Ploufletter si on t’a transféré cette édition 👇🏾
Sur ce, bonne séance 🐋
🐟 Avant le plongeon
Coucou toi ! J’espère que tu vas bien et que le plan d’eau dans lequel tu t’entraînes n’est pas trop asséché. La pluie des prochains jours devrait nous maintenir à flot, au moins jusqu’à l’été. Ici, tout flotte. À l’heure où tu me lis je suis sûrement sous l’eau, à courir en bord de ruisseau.
Si je t’envoie cette missive par poisson volant, c’est pour te parler d’un sujet qui me tient à cœur. J’ai nommé : l'égalité homme-femme. Si tes feeds ressemblent au mien, tu as dû voir fleurir moult publications sur le sujet à l’occasion du 8 mars. Mais, au-delà des prises de parole ce jour-là, on en est où de l’égalité homme-femme ?
Quelques rappels 👇
Aujourd’hui, sur les 29,6 millions de nageur·ses actif·ves en France (Insee, 2017), plus de 14 millions sont des femmes. L’indice de travail féminin est au plus haut. Pourtant :
Seules 17% des professions sont considérées comme mixtes
Les femmes restent minoritaires aux postes à haute responsabilité en entreprises ou en politique
L’écart salarial entre les hommes et les femmes est de 22% en France (2022)
Les femmes continuent à cumuler les rôles et les journées de travail. Dans le foyer, ce sont elles qui s’occupent en majorité des tâches domestiques (72%) et familiales (65%). Cette séparation des rôles influence à la fois la charge mentale, l’énergie, la performance et le développement de leur trajectoires de nage. Cela se répercute – aussi – une fois à la retraite, leur carrière de nageuse achevée
Perso, ça me laisse mi-figue (de mer) mi-raisin. Comment se fait-il qu’on en soit encore à ce stade, quasi soixante ans après l’obtention des droits : de vote, d’accès au travail et de possession de compte en banque ? Quels biais peuvent influencer ces développements socio-natatoires ?
Je te propose donc de plonger ensemble dans ces inégalités. D’abord en remontant à la source, pour comprendre quels sont ces biais de genre et leur origine. Puis, en sortant en eaux libres explorer comment œuvrer pour plus d’inclusivité.
⚠️ Nous allons essentiellement parler des inégalités homme-femme, mais n’oublions pas que celles-ci peuvent se mêler à d’autres formes d’inégalités sociales, ethniques, etc. ⚠️
Fasten your bouée, we’re about to take off 🏊♀️
🤿 pédiluve
cette plouf-letter est-elle faite pour toi ?
🤚Pour faire cet exercice, il te faudra lever sept doigts. You’re good to read. À chaque affirmation dans laquelle tu te reconnais, abaisse un doigt.
Tu as été à l’école primaire / au collège / au lycée
Tu t’es déjà retenu·e de nager dans une certaine direction par manque de représentation dans les profils déjà engagés dans cette ligne d’eau
Tu te demandes pourquoi on pose encore la question « avez-vous prévu d’avoir des enfants ces prochaines années ? »
Tu aimes / tu as toujours rêvé de casser l’ambiance en soirée
Tu as été enfant
Tu as l’impression que ton genre a influencé les projections de ton entourage sur ta trajectoire de nage ?
Tu t’es déjà senti·e obligé·e de t’orienter dans une direction ou d’agir d’une certaine manière pour correspondre à des normes de genre ?
Si tu as répondu « oui » à au moins deux questions, ajuste ton masque de plongée, cette édition va te parler !
🐠 les nageur·ses du jour
Comme toujours, cet article mêle témoignages, recherches académiques et références culturelles diverses.
Je suis donc partie, palmes aux pieds, à la rencontre de pros et membres de la communauté. J’ai échangé fin janvier 2023 avec Candice Barret et Marine Koch, toutes deux nageuses Stéphanoises d’adoption. Diplômées en études de genre, elles poursuivent une mission commune : favoriser l’égalité. Pour ce faire, Candice a choisi de nager sous son propre étendard et Marine a rejoint un club associatif. Toutes deux interviennent dans des centres d’entraînement (aka, structures éducatives1) pour sensibiliser et éduquer aux biais de genre.
Côté nageur·ses, je suis allée faire quelques brasses dans la piscine de l’Agence Spatiale Européenne pour y rencontrer Flavie. Cette nageuse questionne beaucoup la relation qu’a pu avoir son genre sur sa trajectoire de nage. Ensemble, nous avons parlé de son éducation dans une fratrie mixte, double standards de réussite, ingénierie et mixité au travail. J’ai aussi échangé avec Margaux, nageuse en reconversion perpétuelle. Diplômée d’un cursus culturel généraliste, celle-ci a plongé tour à tour dans l’entrepreneuriat, le marketing et la charcuterie. Aujourd’hui, Margaux amorce une nouvelle culbute dans son parcours pour s’orienter vers la comptabilité. Ses domaines de prédilection étant en majorité perçus comme masculins, j’ai donc souhaité en savoir plus sur les fondations de son parcours.
Enfin, comme cela est suffisamment rare pour le souligner, j’ai pu échanger avec deux nageurs : Alexandre et Corentin, respectivement photographe et journaliste. Notre discussion a tourné autour de leur éducation, leur rapport à la créativité et l’orientation. De fait, tous deux se sont lancés dans le grand bain de la vie active en tant qu’ingénieurs avant de culbuter vers des professions plus créatives.
Merci à tous·tes pour vos partages !
🐡 plongée dans les stéréotypes
L’expression biais de genre fait référence à l’ensemble des éléments qui influencent notre représentation des genres, que l’on parle éducation, stéréotypes, langage, etc.
le type, une généralisation…
Tout comme la Comedia dell’arte a recours a des personnages types pour susciter le rire, les stéréotypes rendent génériques des traits personnels. Côté genre, on aboutit à des généralisations telles que : « les femmes sont nulles en maths », « les sciences, c’est pour les mecs » ou encore « les femmes n’ont pas le sens de l’orientation ».
Au-delà du fait que le potentiel comique de ces stéréotypes est limité, l’image que ceux-ci véhiculent est plutôt négative et peut influencer le comportement des personnes concernées.
… qui peut s’avérer handicapante
Le stéréotype devient problématique lorsqu’il entrave les velléités des un·es et des autres à nager dans une direction. C’est ce que l’on appelle « La menace du stéréotype » ou « prophéties auto-réalisatrices ».
Je pense, à titre d’exemple, la relation que les jeunes nageuses peuvent entretenir avec les matières scientifiques pendant leur entraînement2.
« Il y a quelques années, une étude a été menée aux États-Unis. Elle consistait à faire passer un test de mathématiques. On a pris deux groupes mixtes : filles-garçons d’un côté et filles-garçons de l’autre.
À un groupe on leur a dit que c’était de la géométrie, à l’autre on leur a dit que c’était du dessin. Celui à qui on a dit que c’était de la géométrie, les filles sont en échec. Mais pour le groupe à qui on a dit que c’était du dessin, les résultats sont les mêmes côté filles et côté garçons.
C’est pas une question de compétence, d’être meilleur·es ou non en maths, c’est une question de « on a tellement intégré ce stéréotype là, on nous a tellement répété que les filles étaient moins bonnes en maths que ça a altéré nos compétences et ça vient de fait nous mettre en échec ». Candice, au micro du podcast Plouf🏊♀️
Cette « menace du stéréotype » mise en exergue dans l’étude peut influencer les trajectoires natatoires des jeunes espoirs du bassin. Ainsi les jeunes nageuses optent à 74% pour des filières littéraires post bac et seulement 30% d’entre elles font le choix de se tourner vers des eaux plus scientifiques.
Mais comment se construisent ces stéréotypes ?
🐡 plonger à la source : genre et famille, une question d’héritage
tu concourrais dans quelle discipline, enfant ?
Dès notre enfance, notre genre influence notre éducation, nos loisirs ou encore les qualités que l’on développe. Je me suis donc intéressée au choix des activités extra-scolaires des nageur·ses rencontré·es.
Pour Corentin, la réponse est catégorique. L’impact de son genre – masculin – sur ses loisirs est indéniable.
« J’ai fait du rugby, me dit-il. D’ailleurs, j’ai un peu l’impression d’avoir laissé de côté la fibre créative que je développe aujourd’hui. »
Pour Alexandre, la réponse est similaire et la différence fraternelle fortement marquée.
« Moi aussi c’était assez classique, ma sœur a fait de l'équitation et moi du foot. J’ai trois ans de différence avec elle »
Pour Margaux, la réponse est plus mitigée puisque dans sa famille, la notion de performance prévaut sur celle du genre. Enfant, elle rêvait de devenir écrivaine « en sachant pertinemment que je ne le serai jamais ». Puis, elle a nourri celui de devenir styliste et d’y renoncer en voyant les croquis d’autres artistes qu’elle percevait comme plus talentueux·ses qu’elle à son âge. Cet amour de l’excellence, elle le retrouve ensuite dans les activités que lui proposent ses parents.
« J’ai eu le choix entre guitare ou tennis, j’ai fait du tennis » me dit-elle avant de me confier qu’aujourd’hui encore, la performance étalonne la valeur de ses actions. « Si j’arrive pas à un certain niveau (ou si je sais que je ne pourrai pas atteindre un certain niveau), je laisse tomber »
tu rêvais de devenir quel·le nageur·se plus tard ?
Outre nos activités, les modèles avec lesquels on évolue forgent notre perception de la division des rôles – genrés – au sein du foyer et dans la société. Que cela concerne la ligne de nage que l’on emprunte, l’entretien du matériel – à qui cela incombe-t-il ? – ou les honneurs reçus ensuite.
Cette transmission s’effectue à la fois par les images auxquelles on est confronté·es, aux histoires que l’on (se) raconte et à l’environnement dans lequel on nage et influence nos décisions futures.
« Ma mère était femme au foyer. Moi j’ai toujours voulu éviter ça. J’ai besoin de faire quelque chose, de me sentir utile » Margaux
« Mon père est ouvrier, ma mère travaille dans le social, c’était très classique.
Moi, je suis devenu ingénieur » Corentin
Au cours de notre conversation, Flavie me raconte s’est creusé l’écart entre la perception de la réussite féminine que sa famille lui a transmis pendant son adolescence vs. celle transmise à ses frères.
« J’ai cumulé less activités jusqu’en première et comme le rythme était trop intense j’ai arrêté. Ma mère n’était pas contente que j’arrête la musique. Elle aurait préféré que ce soit le sport. Je n’avais pas le droit de réussir dans le sport. Il fallait que ce soit la réussite scolaire. C’était différent pour mon frère qui lui, n’était pas bon à l’école
Idem pour le bac. Pour moi c’était la mention très bien ou rien. Les standards étaient beaucoup plus bas pour mes frères » Flavie
Encore aujourd’hui, cette perception scolaire influence sa manière de percevoir sa trajectoire par un biais très scolaire. « Je sens que je suis encore dans ce modèle travail égale récompense, avant de passer à l’étape supérieure j’ai encore envie d’avoir tout en ordre pour pouvoir prétendre à plus…. »
Le cas de Flavie n’est pas isolé. Outre l’éducation souvent plus stricte pour les jeunes filles devant présenter des qualités comme l’écoute, l’empathie – toutes associées à un rôle support –, celles-ci apprennent dès le plus jeune âge à respecter le cadre vs. l’audace ou la témérité, beaucoup plus valorisées chez les petits garçons.
Voici quelques autres témoignages de nageuses collectés pendant une session questions - réponses collaborative sur le compte Instagram de La piscine 👇
« On m’a fait passer derrière mon frère niveau scolarité, j’étais toujours trop grosse, etc. » Marie
« Beaucoup de restrictions par rapport à mes frères, alors que j’étais plus vieille » Céline
« Les projections de mes parents pour moi n’étaient pas les mêmes pour mes frères » Selma
« Mes frères sont allés en filière scientifique / ingé et moi en filière économique » Emma
Pour Marine et Candice, c'est dans cet apprentissage de « rester sa place » vs. « prendre sa place » que se créent les différences de nos développements personnels ensuite.
« Même quand ils avaient des moyennes en maths entre 6 et 9, les garçons en seconde vont quand même demander à entrer en première S là où les filles pas du tout. Une fille allait se sentir légitime à postuler en S que quand elle avait des bonnes notes – peut importe ce que ça veut dire » Marine, au micro du podcast Plouf🏊♀️
Je pourrai te citer comme exemple le contraste flagrant entre l’approche féminine et masculine des candidatures. La majorité des nageuses s’autorise à postuler pour rejoindre un club de nage si elle remplit au moins 80% des critères sur l’annonce. À l’inverse, les nageurs feront la démarche dès qu’ils en cochent 50%. On pourrait également se pencher sur la négociation salariale, les demandes de promotion, d’augmentation, etc.
Mais alors, comment fait-on pour y remédier ?
🦑 nager en eaux libres - comment renverser la tendance ?
inclusivité dans le langage
Commençons par une devinette : Un médecin a un frère, mais ce dernier n’a pas de frère. Comment cela se fait-il ?
Je te laisse y réfléchir, la réponse est juste en dessous.
…. Le médecin est une femme.
Cette énigme traduit la réalité de notre langage. Même si le terme médecin est épicène, notre imaginaire produit par défaut la figure d’un médecin masculin. Et, je mets mon gant palmé à couper que tes représentations mentales sont similaires si je te parle d’ingénieur·e ou d’entrepreneur·e.
Là est d’ailleurs tout le débat concernant la (re)féminisation de termes en faisant en sorte d’entendre la différence à l’oral – ce qui était d’ailleurs le cas au Moyen-Âge où chaque profession pouvait être nommée au masculine ET au féminin comme nous l’avait rappelé Candice au micro du podcast Plouf🏊♀️ : « On avait trouvé le métier de archer, archère, chevalier, chevaleresse – et ce n’était pas la femme du chevalier mais vraiment une femme qui montait à cheval et qui allait combattre ».
C’est au XVIIème siècle, à la naissance de l’Académie Française, que les termes féminins disparaissent pour faire la place au neutre masculin et à cette règle que nous connaissons tous·tes : « le masculin l’emporte sur le féminin »
Notre architecture de langage témoigne de notre interprétation du monde. D’une certaine manière, parler, c’est tenter de faire chausser tes lunettes de plongée au reste de ton équipe pour qu’iels voient les choses à travers ton prisme. Partager un vocabulaire, des règles de grammaire, etc. à l’échelle sociale, c’est aussi partager une vision des choses. En l’occurence, des visions genrées.
« La société n’est possible que par la langue ; et par la langue aussi l’individu. L’éveil de la conscience chez l’enfant coïncide toujours avec l’apprentissage du langage, qui l’introduit peu à peu comme individu dans la société. […].
La pensée n’est rien d’autre que ce pouvoir de construire des représentations de choses et d’opérer sur ces représentations. La pensée n’est pas un simple reflet du monde ; elle catégorise la réalité, et en cette fonction organisatrice elle est si étroitement associée au langage qu’on peut être tenté d’identifier pensée et langage à ce point de vue. » Benveniste3
Un exemple. Parler de « secrétaire de direction » ou de « bras droit du CEO » n’évoque pas le même prestige, niveau de responsabilité, d’études, âge ou même genre à la personne qui l’entend. « Secrétaire » a une connotation très opérationnelle, aux responsabilités limitées à la gestion d’appels ou de planification de calendrier. Le personnage que j’imagine À l’inverse « bras droit du CEO » fait penser à une personne jeune, dynamique, et masculine. D’ailleurs, en anglais, la différence genrée de ces professions s’entend dans le vocabulaire : « secretary » vs. « right hand man »
Voici un test effectué sur DALL-E où j’ai demandé à l’intelligence artificielle de me créer une image pour le terme de secrétaire – sans mention de genre. Je te laisse voir le condensé de nos clichés. Le terme de secrétaire se teinterait donc encore d’une bonne dose « d’érotisme », saupoudré d’une apparente nostalgie des années 19704 👇
Penser – et qualifier – une réalité inclusive, c’est ouvrir l’imaginaire des possibles professionnels. De quoi permettre à tous·tes les cadet·tes nageur·ses de se projeter dans une ligne de nage, indépendamment de leur genre. Et c’est cette égalité d’imaginaire que revendique Margaux avec son parcours.
« J’aime me dire que c’est possible. Je ne me suis pas posée la question du genre lorsque je me suis orientée vers la charcuterie » Margaux
l’exemple de friends
Le saviez-tu ? Si la série Friends s’était déroulée en France, cet épisode n’aurait peut-être pas vu le jour
The one with the male nanny est sorti sur l’onde en 2002. Dans cet épisode, Ross & Rachel décident d’embaucher une nourrice pour garder leur fille, Emma. Après moult déconvenues et faux départs dans le bassin, le couple se décide à embaucher Sandy, un jeune homme dont la vocation est de prendre soin d’enfants et de les accompagner dans leur développement.
Que ce soit à titre individuel ou des membres du groupe d'ami·es, la décision fait des vagues. Car, dans les esprits, nourrice, c’est un rôle féminin. L’intégration de Sandy dans le foyer Green-Geller est d’autant plus discutée que celui-ci s’avère très au fait de la pédagogie infantile, sensible et à l’écoute. Si ces qualités ravissent les personnages féminins de la série, les hommes ne peuvent s’empêcher de questionner la virilité de ce nourrice.
Mais pourquoi cet épisode aurait-il pu relever du domaine de la fiction en France ?
Figure toi que, jusqu’en 1992, le métier de nourrice / assistante maternelle n’est genré qu’au féminin sur les textes de lois. Ce n’est qu’à cette date qu’un décret inclusif introduit la mixité dans la profession – décret mis en application en 1993. Ce « détail » empêchait de facto tout homme aspirant à se faire agréer assistant maternel de s’élancer dans cette ligne de nage. Aujourd’hui, on compte 3% d’hommes dans cette profession, preuve étant qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à faire sur cette thématique.
Cet exemple, choisi parmi tant d’autres, témoigne de l’influence concrète que peut avoir l’inclusivité sur le développement de nos trajectoires de nage. Peut-être cet épisode a-t-il fait éclore des vocations ? Lancé des conversations sur nos biais de genre ? Incité des employeur·ses à considérer l’inclusivité dans leurs offres d’emploi pour favoriser l’équité ? Qui sait ….
snack break - on 🐚
Connais-tu l’escalator de verre ?
Dans l’épisode de Friends, Sandy révèle à la famille Geller-Green qu’il est très sollicité en tant que nourrice homme dans un métier féminin. L’occasion parfaite de s’élancer à palmes jointes dans le concept du jour : l’escalator de verre.
Ce terme a été inventé en 1990 par Christine L. Williams, sociologue américaine, et fait écho à un autre terme technique que l’on connaît tous·tes : le plafond de verre. À l’inverse du plafond – qui bloque les femmes dans leur ascension professionnelle – l’escalator de verre fait référence à l’accélération de carrière dont bénéficient souvent les hommes évoluant dans des milieux dits « féminins ».
Ainsi, la part de femmes exerçant un métier dans le domaine social est majoritaire – 84% –, mais cela n’indique en rien comment – et si – cette mixité est aussi effective dans la sphère managériale.
Pour Marine Koch, cette vision plus qualitative de la division du travail rendrait notre approche de la mixité – et des défis qui lui sont liés – plus pertinente. Spécialisée en études politiques, elle nous avait donc partagé en guise d’exemple la répartition – genrée – des commissions à l’Assemblée Nationale qui comptabilise 37,3% de députées depuis les dernières élections en 2022.
Le constat est similaire à l’échelle sénatoriale. Si la présidence est formellement paritaire – 4 vice-présidents pour 4 vice-présidentes –, on observe que cette parité est beaucoup plus relative si l’on se penche sur les commissions auxquelles appartiennent les sénateur·rices nommé·es. Les femmes appartiennent à la commission à l’égalité homme/femme, aux affaires économiques, à l’éducation et le social tandis que celles des hommes affichent : finance, défense, et lois constitutionnelles.
Ce phénomène de « ségrégation horizontale » – concernant la nature des postes occupés – complète celui, plus connu, de « ségrégation verticale » en référence à l’accès des femmes aux postes à haute responsabilité. Cette vision plus globale des inégalités permet d’éviter un écueil qui serait de lutter pour l’augmentation numérique des femmes dans un domaine sans se concentrer sur l’aspect qualitatif de la division du travail.
snack break - off 🐚
🦐 ouvrir l'horizon des possibles natatoires - la question de la représentativité
changer nos modèles…
Outre l’inclusivité, dégenrer la direction que prennent nos trajectoires de nage peut passer par l’ouverture de l’horizon des possibles des imaginaires enfantins
« En terminale je ne savais pas où j’allais aller. Aujourd’hui je trouve qu’il est important de confirmer mon choix avec des gens en qui j’arrive à me reconnaître » Flavie
Pendant ma conversation avec Flavie, les blagues sur la parité vont bon train, d’autant plus que celle-ci travaille aujourd’hui dans un milieu plutôt connu pour sa non-mixité : l’aérospatiale.
Pourtant, dans les années 1950, des études médico-psychologiques mettent en exergue les avantages à envoyer une femme dans l’espace, il faudra attendre 1963 pour que la première astronaute – soviétique – décolle. À date, 71 astronautes ont été lancées en vol orbital et représentent un pourcentage minime des astronautes. Mais, si les cohortes aérospatiales peinent à se diversifier, « les fonctions supports sont assez paritaires » – si l’on exclut d’autres formes de diversité – mentionne la nageuse.
Comme je te le mentionnais en introduction, une équipe de nage est considérée comme mixte à partir du moment où la part des hommes se situe entre 40% et 60% de l'effectif (welcome to the jungle). Si la massification de l'enseignement primaire puis supérieur a permis aux filles de se lancer à l'eau, les spécialisations choisies restent très stéréotypée. Ainsi la (feu) filière littéraire est composé à 80% de nageuses tandis que les nageurs se tournaient vers les filières scientifiques et économiques. Cette différence se retrouve dans les études supérieures. par exemple, en CPGE littéraire on compte 76% de nageuses vs. seulement 29% en filières scientifiques (L'orientation au prisme du genre - Cairn)
La question qui se pose concerne donc les modèles qui nous sont présentés pendant notre enfance.
Pour filer l'exemple spatial, à l’école, on nous parle de Thomas Pesquet, sans mentionner Claudie Haigneré qui a exercé en même temps que lui. En sport, on finance et diffuse en priorité les équipe masculines, tout en omettant les performances féminines pourtant tout aussi talentueuses. Ce dont on a surtout besoin comme le mentionne Flavie, c’est de développer un imaginaire métier paritaire, pour que chacun·e puisse se projeter dans une ligne de nage indépendamment de son genre.
« En terminale je ne savais pas où j’allais aller. Aujourd’hui je trouve qu’il est important de confirmer mon choix avec des gens en qui j’arrive à me reconnaître » Flavie
C’est d’ailleurs pour faciliter cette féminisation que des associations sectorielles comme SISTA dans l’entrepreneuriat, 50InTech pour la tech ou encore She Said So pour l’industrie musicale sont nées. Elles proposent – entre autre – l’émergence de nouveaux modèles, du mentorat ou des conférences pour permettre aux jeunes nageuses de s’élancer dans ces domaines.
…et neutraliser les disciplines de nage
Favoriser l’intervention en interne de profils divers sur des thématiques transverses peut également participer à décloisonner notre vision de la division du travail.
Pendant mon année d’accompagnement, peu de maître-nageuses sont intervenues dans mon centre d’entraînement. Les rares à nous avoir partagé leur expertises ont abordé des thématiques « féminines » ; soit, le marketing, l’éditorialisation, la communication ou la prévention des violences sexistes et sexuelles en club.
Pour dé-genrer cette approche professionnelle, la solutions serait alors de faire intervenir des nageuses sur des thématiques perçues comme plus « masculines » comme la levée de fonds, le démarchage, etc. Ou bien, à l’inverse, de faire intervenir des nageurs sur des aspects moins techniques ou monétaires de la gestion de complexe sportif. Le tout afin de banaliser l’association du féminin à d’autres domaines d'expertise natatoires.
👀 so what ?
Difficile de trouver une chute à un sujet aussi complexe.
Aujourd’hui, je me dis surtout que mettre en avant les nageuses et les inégalités encore en vigueur dans une optique d’amélioration, c’est cool. Le cantonner au 8 mars, c’est dommage. D’autant plus que changer nos perceptions, imaginaires et usages, c’est un marathon qui vaut pour toutes formes de mixité.
Dans cette édition de la Ploufletter, on avait parlé de Maboula Soumahoro, professeure et écrivaine, qui percevait sa position académique comme une première pierre vers plus de mixité socio-ethnique académique. De même, l’accès à ce statut seul ouvrait un nouvel imaginaire de réussite pour les jeunes espoirs du bassin non-blanch·es.
Ces processus de changement sont particulièrement long. Et tout ceci demande beaucoup de vigilance pour ne pas régresser, surtout en temps de crise. Il est donc essentiel de continuer à se battre pour faire évoluer nos horizons de nage.
Alors, prêt·e à œuvrer pour le 8 mars tous les jours ?
🎙 « pour ouvrir l’horizon des possibles, on a vraiment tout un travail à faire autour de la représentation »
La rencontre du jour au bord du bassin ne se lit pas, elle s’écoute !
Cet épisode du podcast Plouf🏊♀️, enregistré au cours du Festival de l’Apprendre en janvier 2023, explore le sujet des inégalités de genre sur le prisme de notre éducation.
Je te laisse donc en compagnie de Marine Koch et Candide Barret 👇
Et crawle par ici pour lire la transcription
🛠 quelques ressources pour aller plus loin
👉 L’édition précédente de la Ploufletter sur les inégalités de genre en entreprise
👉 Le TED de Lily Singh, youtubeuse et humoriste A seat at the table isn't the solution for gender equity (Faire la place n’est pas la solution de l'égalité), 2022
👉 Le TED de Sara Sanford How to design gender bias out of your workplace (Concevoir un environnement de travail pour éliminer les biais de genre), 2020
👉 La vidéo Votre cerveau vous biaise de la série Matière Grise par Fabien Olicard avec Simon Astier. Ils plongent ensemble dans l'exploration de nos biais cognitifs
👉 L’article Le parcours de carrière des femmes - comment dépasser les prophéties autoréalisatrices ? qui se penche sur la menace du genre
Ça t’a plu ? Fais passer le mot !
👉 Cette édition a résonné avec ton expérience de nageur·se ? Envoie moi un email si tu souhaites témoigner
👉 Tu ressens le besoin d’être accompagné·e dans ta réflexion professionnelle ? Tu peux aller faire un tour du côté du shop de La piscine ou m’envoyer un email pour échanger sur tes besoins
👉 Tu fais partie d’une structure éducative / entreprise et ces sujets d’orientation / quête de sens animent vos équipes ? Envoie moi un email (hello@thewhy.xyz) si tu veux que l’on en discute ensemble
À très vite pour un nouveau plongeon 🐋
Apolline
Tu peux aussi nous retrouver sur instagram : https://www.instagram.com/ourmillennialstoday/
Note de bas de page : Par ici pour découvrir le vocable de La piscine https://ourmillennialstoday.me/comprendre-le-vocabulaire-de-la-piscine
Exemple pris tout à fait au hasard
Benveniste E., 2012, Dernières Leçons. Collège de France, 1968 et 1969, édition établie par J.-CL. Coquet et Irène Fenoglio, Paris, Gallimard-Seuil
Sans parler de la touche raciste ou classiste que l’on peut voir dans les représentations masculines que me propose DALL-E…